Le portrait de Rimbaud, d’Ernest Pignon-Ernest, est édité dans plus de 200 livres sur le poète français. Le père fondateur du street-art rend hommage à l’écrivain qu’il admire. En 1978, il colle plusieurs centaines de ces images à Paris et à Charlerois, ville de naissance de Rimbaud. Cette série, d’Ernest Pignon-Ernest est sa plus connue. Elle donne un aperçu du travail initiateur de l’artiste urbain, et de la conception singulière de son art. Retour, en portrait, sur le pionnier du street art.
Sommaire

« J’essaye de saisir et d’appréhender tout ce qui se voit : la texture du mur, la couleur et simultanément j’étudie tout ce qui ne se voit pas. C’est-à-dire l’histoire du lieu, sa mémoire, les souvenirs enfouis… » Explique Ernest Pignon-Ernest dans une interview pour Nouvo. Après avoir réalisé des dessins d’architecture, le jeune niçois né en 1942 s’installe dans le Vaucluse.
Passionné par les peintres ; fan de Picasso, Le Greco ou encore Bacon, il comprend vite que la peinture ne peut contenir toutes ses idées : en 1966, il veut dénoncer l’installation de missiles nucléaires dans sa région du Vaucluse, sur les plateaux d’Albion. La présence de la mort près de chez lui est alors trop forte, trop violente pour n’en faire qu’un tableau : « Cette implantation de cette puissance de mort, c’est une agression qu’on faisait au pays lui-même. Il fallait donc intervenir directement sur le pays. C’est comme ça que j’ai commencé à mettre des images sur les lieux eux-mêmes. »
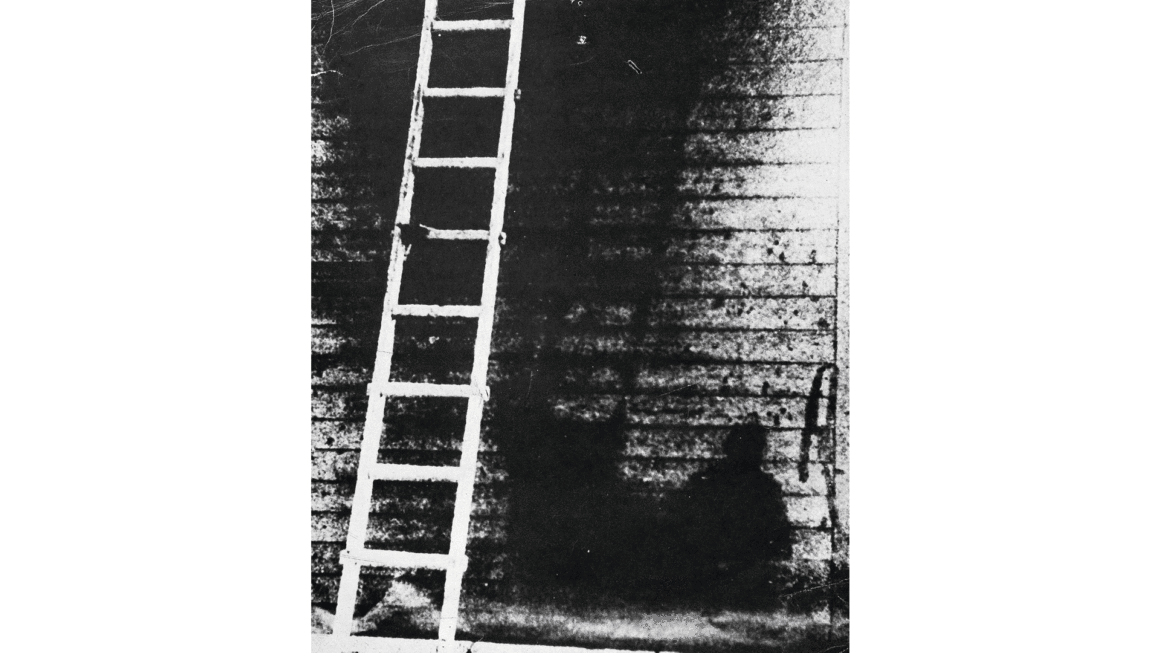
Le premier travail d’Ernest Pignon-Ernest annonce ses nombreuses autres images. Ici, l’artiste alerte la menace nucléaire qui pèse sur sa région. Pour créer cette image, il se documente sur la catastrophe nucléaire d’Hiroshima. Partout dans le Vaucluse, murs, routes, rochers, l’artiste colle ces « empreintes d’Hiroshima », comme un signal d’alerte. Ses pochoirs montrent l’ombre d’un homme décomposé par un éclair nucléaire.
Lieux et mémoires
Après ses pochoirs dans le Vaucluse, ce fils d’une coiffeuse et d’un ouvrier aux abattoirs de Nice se consacre pleinement au nouvel art qu’il vient de “fonder” : le street-art. Avant-gardiste, il réalise un travail de fourmis, presque d’historien sur les œuvres qu’il compte afficher dans les rues : « Quand je vais travailler dans un lieu (…) je vois comment on l’appréhende, je vois la texture du mur, sa couleur. Je fais une appréhension de tout ce qui se voit, mais en même temps, je travaille tout ce qui ne se voit pas. »
« Mon travail vise, même en traitant des thèmes très contemporains, à faire résonner l’histoire, les grands mythes qui nous fondent. »
Ernest Pignon-Ernest.
Pour sa série sur Naples, réalisée entre 1988 et 1995, il avoue sur le plateau de 28 minutes, détenir 92 livres sur la ville.

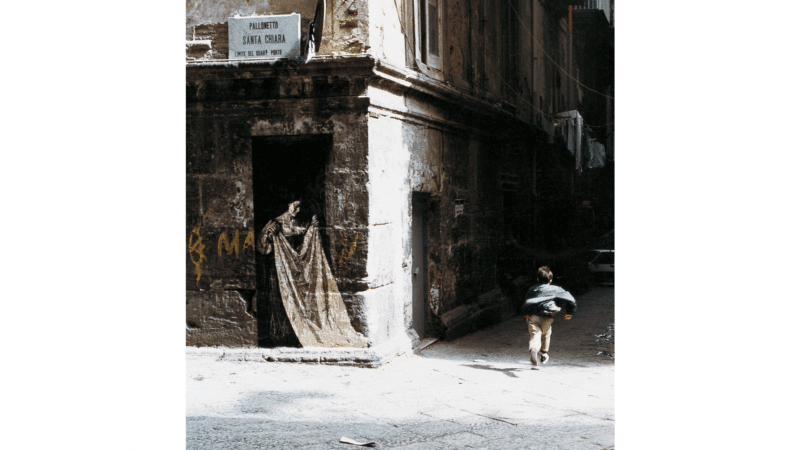
L’artiste s’intéresse ici aux mystiques et aux représentations de la mort dans cette ville du sud de l’Italie. Il y colle environ 300 images et explique qu’interroger ces mythes, ces rites de morts, les femmes, les origines des hommes a nécessité un gros travail : « C’est une quête au long cours, qui a duré des années. »
Il s’est documenté sur les déclinaisons mythologiques grecques, mythologies romaines et chrétiennes. Mais aussi sur plusieurs figures mythiques comme Hildegarde de Bigen ou Thérèse d’Avila, figure importante de la spiritualité chrétienne.

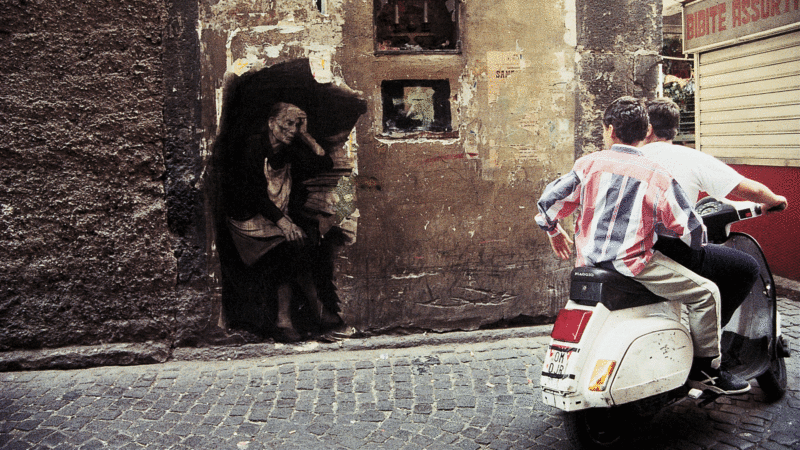
Tous ses travaux s’inscrivent dans une logique historique et mémorielle. Ernest Pignon-Ernest veut saisir la complexité des lieux qu’il souhaite occuper. Pendant plusieurs heures, il observe la lumière d’un mur, ses nuances, ses couleurs, mais aussi sa symbolique : l’artiste ne travaille pas n’importe où. Il choisit avec minutie des lieux chargés d’histoire et de sens.
Un artiste engagé
La majeure partie des collages d’Ernest Pignon-Ernest sont politiques. Plusieurs séries de l’artiste résonnent particulièrement avec l’actualité. Sa série “Les expulsés” suscite beaucoup de questions. Alors que ses parents sont expulsés de leur logement à Nice, la ville procède à des rénovations. Le père du l’art urbain ressent la douleur de l’exclusion, d’être chassé « d’un lieu de son histoire. »
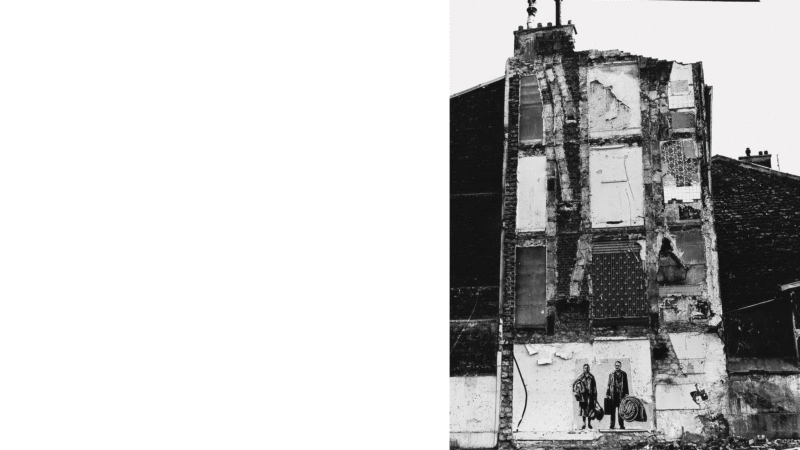
« Cette exhibition me semblait d’une grande violence, comparable à un viol. »
Ernest Pignon-Ernest

Ernest Pignon-Ernest dénonce l’apartheid dans une série, en 1974. Il est alors furieux de la décision de sa ville, Nice. La municipalité décide de la jumeler avec le Cap, centre du racisme institutionnalisé. Il colle alors sur les murs des images d’une famille noire, grandeur nature, derrière des grillages.

« j’ai figuré le cortège des absents : des centaines d’images d’une famille noire parquée derrière des barbelés »
Ernest Pignon-Ernest
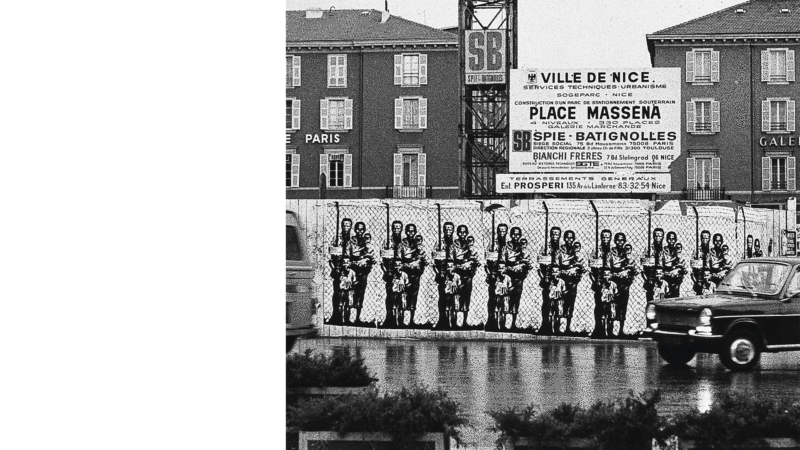
Il lutte pour l’avortement dans une série qu’il expose à Paris en 1975. Il avait déjà réalisé une affiche pour le MLF (Mouvement de Libération des Femmes). Elle avait pour slogan : « Chaque année, un million de femmes avortent, 5 000 en meurent. »
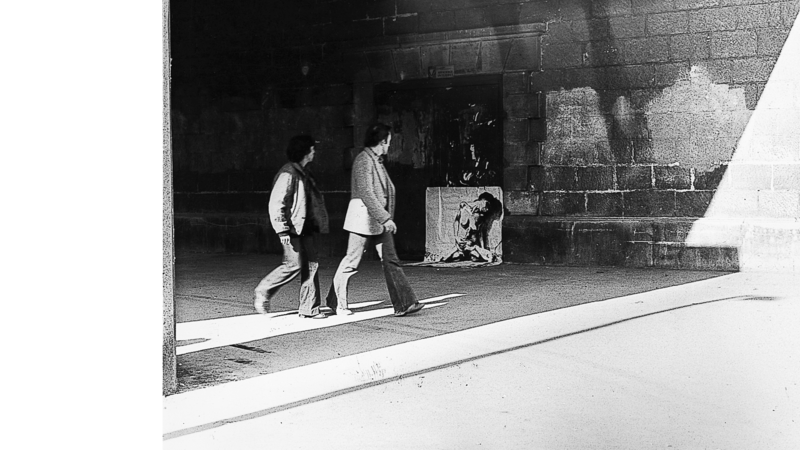
Pour “Avortement”, Ernest Pignon-Ernest affirme avoir voulu détourner le slogan réactionnaire : « L’avortement tue » par : « Oui, l’avortement tue, mais d’abord les femmes ! ». Il explique aussi qu’il était difficile de représenter des femmes nues dans la rue.

« Si je dessine des hommes depuis toujours, c’est que je crois extirper des choses fortes. » Ernest Pignon-Ernest place les Hommes au centre de ses collages. Artiste engagé, il installe le portrait de Mahmoud Darwich, poète palestinien, sur le mur de séparation entre l’Israël et la Palestine.
« J’utilise le temps, l’espace, la mémoire. J’essaie de faire de la rue une œuvre, alors que la plupart des gens du street-art font de la rue une galerie, un lieu d’exposition »
Ernest Pignon-ernest, France Inter
Bien avant JR, Banksy ou C215, Ernest Pignon-Ernest créé un art singulier : l’art de rue, ou le street-art.
Fondateur du street-art malgré-lui
Le père fondateur de l’art urbain n’aime pas qu’on le qualifie comme tel. Pourtant, il est bien le précurseur du street-art. Mais dans une interview pour Clique, il explique pourquoi ses œuvres ne peuvent être assimilées au street-art : « si on peut parler d’œuvre dans mon travail, ce sont les lieux eux-mêmes (…) on ne peut pas séparer mes dessins du lieu. » Alors que Banksy peut vendre pour plus d’un million d’euros, “La fille au ballon”, Ernest Pignon-Ernest ne conçoit pas séparer ses œuvres du lieu où elles ont été collées.

Pour saisir le travail de l’artiste, il faut se rendre sur place ou visionner des photographies qui rendent compte à la fois de l’œuvre créée par l’artiste dans son environnement.
Ernest Pignon-Ernest ne travaille pas de la même façon que les graffeurs de nos jours. Il dessine au fusain, au crayon dans son atelier parisien. Selon Street Avenue, il dessinerait aussi à l’aide de pierres noires et de gommes crantées de différentes épaisseurs. Les matériaux choisis ont tous leur importance pour lui. Ainsi, lorsqu’il réalise plusieurs “portraits” de Rimbaud, il préfère les dessiner sur du papier.
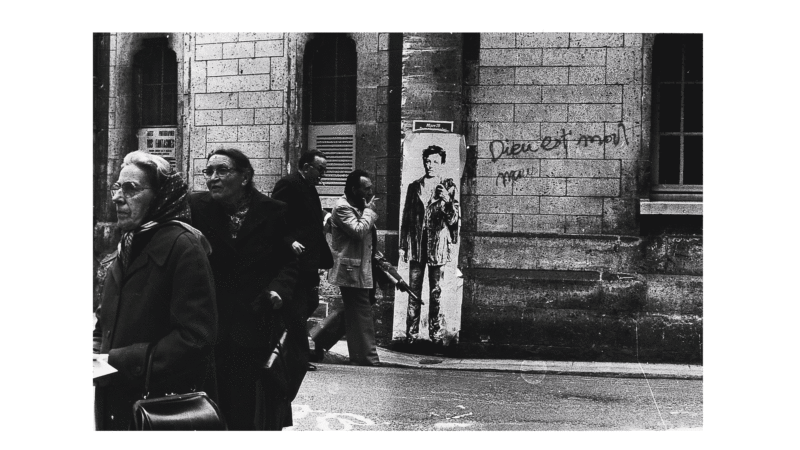
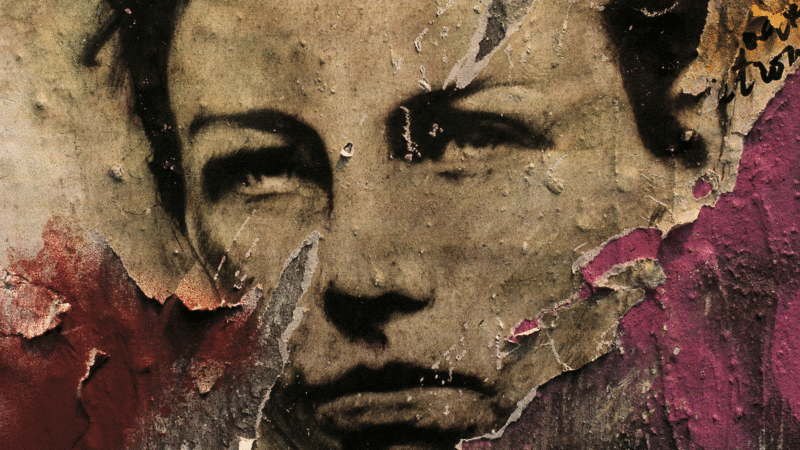
« Depuis mon adolescence j’ai cycliquement tenté de faire un portrait de Rimbaud mais je crois que lorsqu’on a lu Rimbaud, vraiment, on sait que l’on ne peut pas en faire un portrait. Je veux dire qu’on ne peut pas faire un Rimbaud en marbre, en bronze, un Rimbaud sur un socle ou dans un cadre. »
Ernest Pignon-Ernest
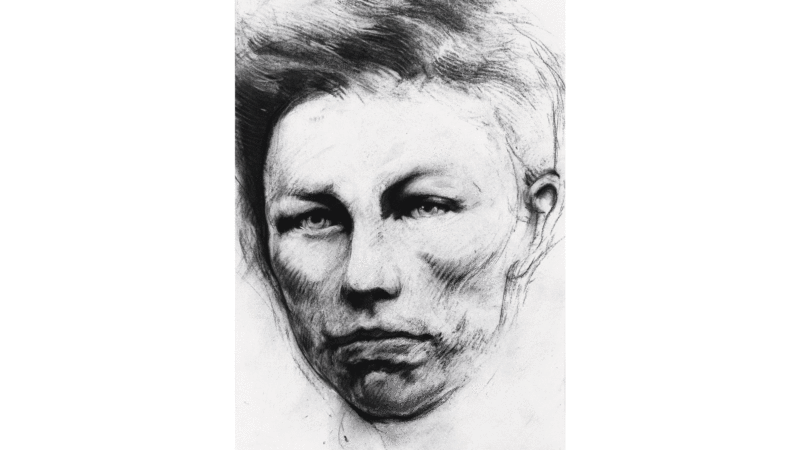
Ces images de Rimbaud dessinées par l’artiste en sérigraphie noire ont été imprimées sur du papier journal. Il était important, pour Ernest Pignon-Ernest de visualiser la vulnérabilité et la pauvreté de cette série, mais aussi son caractère frêle et altérable : « Sa disparition est inscrite dans l’image même, elle en est – autant que ce qui compose le dessin – un des éléments suggestifs et poétiques, peut-être ce qu’il y avait de plus rimbaldien dans cette intervention. »
Mondialement connu, Ernest Pignon-Ernest a été exposé à plusieurs reprises, dans le monde entier. En 2020, 400 de ses œuvres sont affichées pour “Ecce homo”, une exposition rétrospective de l’artiste dans la nef de la grande chapelle du palais des papes à Avignon.

Pour sa série “Prisons”, l’artiste est exposé à Paris en 2014 à la Galerie Lelong et à la galerie Fait et Cause.

Avec cette série, il souhaitait redonner sans juger, une place à l’histoire humaine. Il réalise “Prisons” avant que celle-ci ne devienne un campus universitaire.
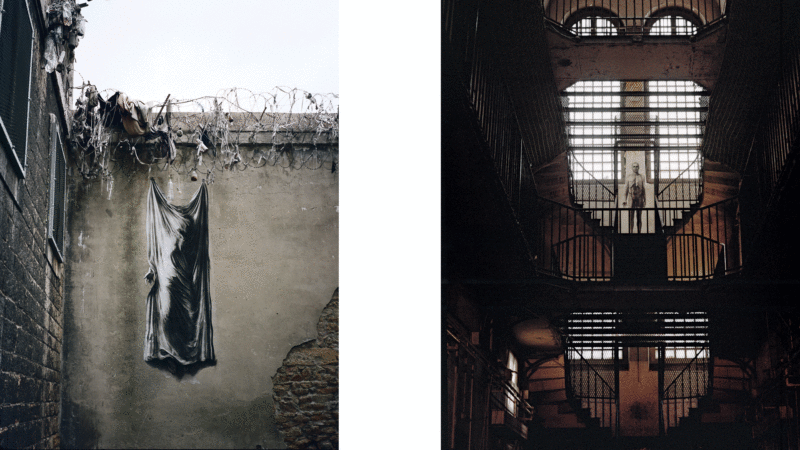
Pour en savoir plus sur l’artiste : son site officiel.
Vous pouvez consulter notre article sur un artiste engagé, surnommé le “Banksy australien“




1 commentaire
Boscher
Bon travail.